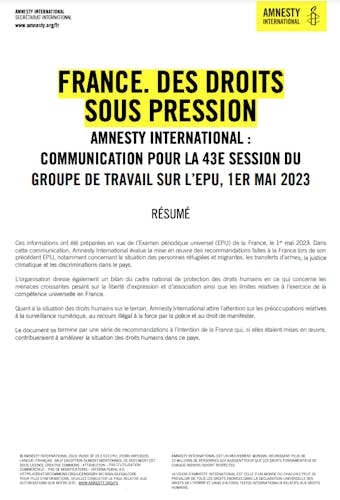Le 1er mai, la France était sous le feu des projecteurs à l’occasion de l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, pour la 4ème fois de son histoire. Plus de cinq ans après le dernier EPU, l’heure du bilan international du premier mandat d’Emmanuel Macron a sonné.
Le 1er mai, la France a présenté son bilan en matière de droits humains devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à l’occasion de l’Examen périodique universel (EPU). Ce mécanisme permet, tous les cinq ans environ, d’évaluer la manière dont chacun des 193 États membres de l’ONU respecte ou non ses engagements en matière de droits humains.
L’occasion de dresser un bilan de la politique de droits humains de la France ces cinq dernières années, sous le mandat d’Emmanuel Macron. Alors quelle est la tendance générale de notre pays : assiste-t-on à une régression de nos droits ou une amélioration de la situation ? Nous étions à Genève le 1er mai pour observer en direct ce qu’en pensent les États. Explications.
L’EPU, comment ça marche ?
L’examen périodique d’un Etat est un cycle de six mois.Il commence par un dialogue interactif à Genève qui permet aux autres Etats de formuler des recommandations à l’Etat examiné sur des éléments de sa politique de droits humains et de remarquer des progrès ou au contraire des reculs ou aggravations depuis l’examen précédent.
Le 1er mai, la France recevra l’ensemble des observations des Etats. Elle aura ensuite jusqu’à novembre pour répondre à chaque recommandation, en l’acceptant ou en la refusant. L’EPU s’achèvera alors, avec l’adoption d’un rapport définitif qui constituera un engagement politique fort de la France. Les recommandations acceptées par la France pour un meilleur respect des droits humains serviront de feuille de route des engagements à mettre en œuvre par la France, sur laquelle s’appuieront la société civile et le Parlement pour les cinq années suivantes. C’est là toute l’importance de l’EPU : obtenir des engagements concrets pour s’assurer qu’ils soient mis en œuvre.
Ce sera précisément le rôle d’Amnesty International : se mobiliser pour rappeler le gouvernement français à ses promesses prises devant la communauté internationale.
Des droits humains sous pression, malgré de timides progrès
Ces cinq années, depuis le dernier examen de la France, peu d’avancées majeures ont été enregistrées. Nous saluons tout de même :
l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité pour les enfants étrangers, quel que soit leur statut administratif sur le territoire ;
la poursuite des politiques permettant aux personnes transgenres d’obtenir plus facilement la reconnaissance de leur genre à l’état civil.
Nous déplorons toutefois de nombreuses promesses non-tenues.
👉 Sur le droit de manifester. Alors que les attaques se multiplient contre le droit de manifester, peu de progrès ont été constatés sur l’application des recommandations de 2018, pourtant acceptées par la France, relatives à l’usage illégal de la force par la police et de ses répercussions sur l’exercice de ce droit.
👉 Sur la liberté d’expression et d’association. La loi d’août 2021 visant à « renforcer les valeurs républicaines » a accru les menaces qui pèsent sur la liberté d’expression et d’association en France.
👉 Sur les transferts d’armes. Alors que la France avait accepté une recommandation de 2018 à ce sujet, les transferts d’armes classiques risquant d’être utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains se poursuivent.
La France épinglée
A l’occasion de cet examen, de nombreux Etats ont exprimé de vives inquiétudes, notamment sur l’usage excessif de la force et les pratiques discriminatoires des autorités de maintien de l’ordre.
En adéquation avec nos demandes, plusieurs pays dont le Luxembourg et la Suisse ont appelé la France à repenser sa doctrine de maintien de l’ordre, pour aller vers des stratégies de désescalade et prendre en compte les impératifs d’usage proportionnel et nécessaire de la force.
Les pratiques discriminatoires telles que le profilage racial ont été dénoncées, ainsi que les nombreuses atteintes aux droits des migrants et demandeurs d’asile. Certains pays ont fait part de leurs inquiétudes concernant les femmes et les enfants migrants en particulier.
L’Afrique du Sud a quant à elle appelé les autorités françaises « à prendre des mesures pour garantir des enquêtes impartiales par des organes véritablement indépendants, et extérieurs à la police, dans tous les cas d’actes racistes impliquant des policiers ».
De nombreux pays, dont l’Irlande, ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’accompagnement, la protection et l’accès à la justice des femmes victimes de violences.
Usage excessif de la force, pratiques discriminatoires, droits des minorités de genre, des migrants ou des enfants mis à mal… Malgré ses discours, malgré les progrès qu’elle a mis en avant lors de son examen, la France n’est pas exemplaire en matière de droits humains.
Nos principales demandes
Notre rôle est d’appeler la France à se saisir pleinement de l’EPU pour répondre aux critiques qui lui sont faites et d’y répondre via des engagements concrets pour les droits humains. Nous veillerons à ce qu’elle tienne ses promesses !
Pierre Albrieux, Coordinateur plaidoyer
Nous appuyons les demandes faites à la France de :
réformer la doctrine de recours à la force pour le maintien de l’ordre.
respecter les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants.
permettre aux victimes d’accéder à la justice en rendant possible la pleine application de la compétence universelle.
Parmi nos principales recommandations figure également nos demandes concernant la surveillance numérique ciblée.
Qu’est-ce que la surveillance numérique ciblée ?
Il s’agit d’un système de contrôle ou d’espionnage de personnes ou organisations spécifiques, pouvant intéresser les autorités, à l’aide de technologies numériques. La surveillance numérique ciblée peut passer, entre autres, par le piratage des appareils via l’installation de logiciels malveillants ou espions, ou par des campagnes d’hameçonnage compromettant les communications numériques.
En juillet 2021, les révélations Pegasus ont dévoilé un scandale mondial de cybersurveillance. Depuis et dans le monde entier, des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits humains continuent d’être illégalement espionnés, permettant ainsi de graves violations du droit au respect de la vie privée, de la liberté d’expression, d’association ou encore de réunion pacifique. Près de deux ans après les faits, le secteur ne fait l’objet d’aucune véritable régulation et se développe dans la plus grande impunité.
Ce premier EPU depuis les révélations Pegasus doit être l’occasion pour la France de jouer un rôle moteur pour prévenir et empêcher les atteintes aux droits humains liées aux technologies de surveillance numérique ciblée.
Notre demande : la France doit se positionner fortement et publiquement en faveur d’un moratoire mondial sur la vente, le transfert et l’utilisation des logiciels espions, jusqu’à ce qu’un cadre règlementaire solide et respectueux des droits humains soit mis en œuvre.
Les défis sont nombreux. La France doit maintenant prendre la mesure de toutes les critiques formulées par les Etats comme la société civile, et prendre des engagements concrets et ambitieux pour y répondre.