Pourquoi des communes sans histoires investissent-elles dans la vidéosurveillance ? Notre reporter s’est rendu dans un village des Alpes-Maritimes, où le maire a installé des caméras afin de prévenir des infractions… parfois imaginaires.
Il a constaté comment, là comme ailleurs, l’État incite les petites communes rurales à s’équiper, malgré une criminalité quasi inexistante. En assistant à la fête annuelle des industriels du secteur, il s’est fait expliquer leur stratégie visant à étendre davantage la vidéosurveillance dans les campagnes.
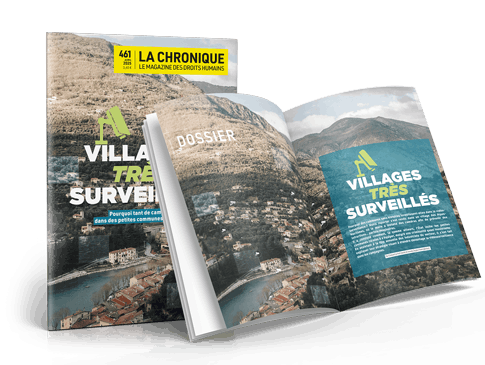
Extrait de La Chronique d'avril 2025 #461
Par Clément Le Foll (texte) et Jeremy Suyker/item (photos).
« On ne sait jamais... »
De plus en plus de maires de villages cèdent à la vidéosurveillance. Reportage à Breil-sur-Roya, commune paisible… et bientôt l’une des plus surveillées de France.
Il est là depuis des mois, perché au sommet d’un poteau au bord du petit lac de Breil-sur-Roya, un village de près de 2 000 habitants des Alpes-Maritimes. Un œil numérique, silencieux, scrutateur. Le jeune maire Sébastien Olharan (LR), costume bleu marine et baskets assorties, l’observe avec fierté. Sa nouvelle arme pour protéger les Breillois : la vidéosurveillance. Mais cet après-midi de janvier balayé par le vent, la caméra ne capte rien. En surplomb du lac, les gradins remplis lors des spectacles estivaux sont vides. Le bar associatif qui les jouxte est fermé en hiver.
À quoi bon surveiller ce lieu désert ? Le maire répond : « Pour que personne ne décroche une barque amarrée au ponton pendant l’été. » Mais pourquoi ? Est-ce déjà arrivé ? « Non », admet-il. Une menace hypothétique justifie-t-elle alors de soumettre les citoyens à une surveillance permanente ? À ses yeux, certainement. Et pour défendre sa cause, il renverse l’argument : « Si aucune infraction n’a eu lieu, c’est bien la preuve que les caméras dissuadent ! »
En 2020, Sébastien Olharan avait inscrit l’installation de ces caméras dans ses promesses de campagne. Depuis quelques mois, elles se multiplient. Aux entrées et sorties du village, devant la gare, l’école, le collège… Bientôt, 40 surveilleront la commune. Une pour 50 habitants. Plus qu’à Nice, championne de la vidéosurveillance avec ses 5 000 caméras – une pour 70 habitants. À Breil-sur-Roya, tout le monde se connaît. Les voisins s’appellent par leur prénom. Pourtant, ce paisible village va devenir l’un des plus surveillés de France. Le maire le justifie en évoquant des « incivilités ». Il énumère une série de plaintes reçues depuis son élection, il y a quatre ans, qu’il partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Ses administrés, affirme-t-il, doivent faire face à « du vandalisme » : « des poubelles renversées », « un graffiti sur une borne canine ». Certains se sont plaints d’« une voiture mal garée », de « cartons abandonnés », d’un scooter roulant « de façon incessante et polluant », d’un « vol de géraniums », d’un tag noir griffonné sur un mur de la rue Pasteur (« Heureux comme vit la joie ») ou de « six ou sept individus [qui ont] fait la java jusqu’à 1 h 30 du matin ». On imagine mal des caméras empêcher certains villageois de vivre bruyamment ou de jeter des détritus. Mais il y a, selon le maire, plus grave que ces nuisances quotidiennes connues de tous. Ici, dit-il, « la délinquance progresse ». Un trafic de drogues dures est en train de s’installer dans la vallée et génère « des points de deal ». Où sont-ils ? À quoi ressemblent-ils ? « Ils se déplacent régulièrement, commente le maire. Cela dépend des moments, nous en avons principalement identifiés au centre historique et dans le secteur gare. » Des caméras ont donc été installées dans ces zones ? « Non, à proximité, car évidemment, ils ne sont pas plus bêtes que la moyenne, ils vont déplacer le point de deal ! », poursuit Sébastien Olharan.

À Breil-sur-Roya, commune des Alpes-Maritimes, une caméra surveille le parvis de la gare.
Un lieu déjà investi à longueur d’année par les gendarmes qui traquent les personnes migrantes arrivant d’Italie
Ces « points de deal », cette augmentation de la délinquance, les habitants de Breil-sur-Roya peinent à les voir. Comme Djamila, la postière. Nous la croisons en train de sortir un colis de sa camionnette. « De la délinquance, ici ? Parfois quelques bêtises, mais rien de plus que partout ailleurs ! » Dans le chalet qui, en hiver, fait office d’unique bar au sein du village, Michel Masseglia, Pippo Oliveri et Sylvain Gogois sont tout aussi sceptiques. Selon eux, cette prétendue hausse de la criminalité tient de la « fable ». Respectivement ancien salarié de la direction départementale de l’équipement, cheminot et enseignant, tous les trois vivent à Breil-sur-Roya depuis des décennies. Anciens élus parfois dans l’opposition, parfois dans la majorité, ils dépeignent un village vieillissant, où l’essentiel de la population travaille dans un Ehpad ou à l’hôpital local. « Pas vraiment une zone chaude, contrairement à ce que veut faire croire le maire », ironise Pippo en remuant son café.

Depuis juin 2023, des militaires de l’opération Sentinelle patrouillent dans Breil- sur-Roya pour épauler les gendarmes qui surveillent la frontière.
À la recherche de la délinquance
L’un des opposants les plus virulents aux caméras du maire s’appelle Cédric Herrou. L’agriculteur a fait la une des médias pour avoir accueilli des migrants en détresse sur ses terres à la fin des années 2010. Avec eux, il a fondé une communauté Emmaüs paysanne. Il nous reçoit, à l’heure du déjeuner, dans la maison de cette communauté, et nous dévoile les chiffres des crimes et des délits sur la commune, extraits des statistiques de l’Insee et du ministère de l’Intérieur. Ces chiffres de 2023 le confortent dans l’idée que Breil-sur-Roya est « dépourvue de délinquance et de troubles à l’ordre public ». Vols violents ? Zéro. Trafic de stupéfiants ? Zéro. Usage de stupéfiants ? 16 (contre 27 en 2020). Les pires violences recensées sont « 14 coups et blessures volontaires ». C’est certes beaucoup. Mais ce sont des violences « intrafamiliales », indiquent le ministère de l’Intérieur… « Ce qui veut dire des violences commises à l’intérieur des maisons, ajoute Marion Gachet, co-responsable d’Emmaüs Roya. Et contre ces violences, filmer les rues ou les places publiques ne sert strictement à rien. » Le couple d’agriculteurs rappelle que Breil-sur-Roya se trouve à cinq kilomètres de la frontière italienne, dans une zone de passage de personnes migrantes en situation irrégulière.

Pippo Oliveri, Sylvain Gogois et Michel Masseglia, trois habitants historiques, militent contre l’installation d’un système de vidéosurveillance dans leur commune. Pour ces anciens élus, la commune a besoin en priorité de structures d’accueil pour les jeunes.
Et donc, depuis des années, sous très haute surveillance. Des policiers municipaux, des gendarmes et des militaires de la mission Sentinelle patrouillent tous les jours à la gare, sur les routes d’entrée et de sortie de la commune. Conformément aux consignes du préfet qui fait la chasse aux personnes sans papiers, les forces de l’ordre vérifient l’identité des passagers descendant des trains et des bus. Cédric Herrou remet aussi en question le prix de la vidéosurveillance. Au départ, le maire annonçait 100 000 euros. L’addition atteint désormais 250 000 euros. Sébastien Olharan minimise : « Ce n’est que 1 % du total des investissements que j’ai réalisés depuis le début de mon mandat. Et 80 % de la somme sera réglée par des subventions. » Mais, pour l’agriculteur, cet argent va « à des caméras dont l’efficacité n’a jamais été scientifiquement prouvée, alors que le village est en demande d’investissements bien plus prioritaires ».
Une jeunesse délaissée
Attablé avec ses acolytes Michel et Sylvain, Pippo pointe du doigt une maison à la façade lézardée. « La priorité, c’est ça ! », lance l’ex-cheminot. Les stigmates de la tempête Alex, qui a dévasté la vallée en 2020, demeurent partout visibles. Sylvain et Pippo nous emmènent le long de la Roya, jusqu’à l’ancienne piscine municipale. Noyée il y a cinq ans par les eaux de la tempête, elle n’a jamais été réparée. Plus qu’un équipement sportif, c’est un décor apocalyptique : bouées crevées échouées dans les piscines vides, carrelage éclaté, algues et ronces envahissant les bassins. Pippo secoue la tête. « Moi, je n’ai rien contre les caméras, mais, ici, vous voyez un chantier beaucoup plus urgent pour le village : réhabiliter cette piscine. Il faudrait aussi relancer le projet de maison des jeunes qu’on avait amorcé sous la précédente mandature. » Michel complète : « C’est vrai, les jeunes s’ennuient : ils n’ont plus de piscine, plus de stade, et ils attendent toujours le skatepark que le conseil municipal des jeunes réclame depuis des années ! » Antonin Tricot connaît bien la jeunesse de Breil-sur-Roya, à laquelle son association Graine de vie offre des activités. Lui-même est salarié de la mission locale, où il aide les 18-25 ans à s’insérer dans la vie active. Arrivé au village il y a trois ans, ce trentenaire est dubitatif sur la politique des caméras : « Je n’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de délits ou de criminalité, ici. Et s’il en existe et que c’est lié aux jeunes, je pense qu’il faut travailler avec des éducateurs, proposer aux jeunes des activités et mieux les encadrer. »

La piscine de Breil-sur-Roya n’a jamais été réhabilitée après le passage de la tempête Alex en 2020
Des référents sûreté convaincants
Sébastien Olharan n’est pas le seul maire d’un village paisible ayant décidé de surveiller ses habitants. En décembre 2021, 32 communes des Alpes-Maritimes de moins de 5 000 habitants avaient installé des caméras. De l’ultra-chic Villefranche-sur-Mer aux villages reculés d’Isola, la vidéosurveillance s’étend chaque année un peu plus, portée par un système bien huilé. Sébastien Olharan explique qu’un « référent sûreté » l’a guidé tout au long du processus d’installation. Présent dans chaque département depuis 1995, le référent sûreté est un gendarme formé à la vidéosurveillance afin de conseiller les maires sur l’installation de caméras et les subventions publiques disponibles pour les financer. On en compte aujourd’hui près de 300 en France. Celui de Sébastien Olharan a d’abord réalisé un « diagnostic de sécurité ». Ce document de 15 pages, que nous avons pu consulter, est censé évaluer le besoin du village en sécurité, mais ne soulève jamais la question de la nécessité des caméras. Il indique simplement où elles doivent être implantées. La gendarme Jessica Cagne, référente sûreté dans la région d’Avignon, confirme son rôle incitatif : « Quand nous identifions un vide en vidéoprotection sur un territoire, nous organisons des rendez-vous avec le maire et les services municipaux pour leur démontrer l’intérêt des caméras. »
C’est ainsi qu’a procédé le référent sûreté de l’Aveyron avec le maire de Marcillac-Vallon (1 714 habitants). En août 2020, il a pris la parole au conseil municipal. Après avoir présenté aux élus une liste de dix communes voisines déjà équipées, il leur a recommandé l’installation d’une caméra pour 300 habitants. Convaincu, le maire Jean-Philippe Périé a débloqué 18 000 euros pour implanter cinq caméras, dont une devant l’école afin de « prévenir les intrusions ». Alors qu’aucun incident de ce type n’a jamais été signalé… Mais « on ne sait jamais ! », justifie le maire dans les colonnes de 20 Minutes, daté du 6 avril 2021. Selon le rapport de son référent sûreté, les caméras sont également supposées « prévenir des tags au niveau de la salle des fêtes » et « endiguer la délinquance sur la commune ».
« Des préfets accordent des autorisations d’installation de caméras dans des communes où le niveau de la délinquance est faible »
— Extrait du rapport de la Cour des comptes sur les forces de sécurité publique, juillet 2011
2 900 signatures contre les caméras
Loïc Santiago, un villageois, est consterné : « Nous sommes un village où il fait bon vivre, c’est totalement disproportionné d’installer cinq caméras alors que d’autres moyens moins attentatoires aux libertés existent. » Il a monté un collectif citoyen. Une pétition contre les caméras recueille 2 900 signatures. Mais le combat prend fin en juin 2023, lorsqu’un tribunal administratif entérine leur installation. Pourtant, le diagnostic de sécurité rédigé en 2021 affirme ceci : « L’analyse de la délinquance sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 montre que la commune reste épargnée par des faits majeurs, et les chiffres restent stables d’une année sur l’autre. » Et ce n’est pas tout. Selon la brigade départementale de renseignements et d’investigations judiciaires [unité de la gendarmerie nationale], le nombre d’interventions de la police a même diminué durant cette période, passant de 134 à 119 par an. Alors, pourquoi imposer une surveillance permanente aux villageois ? Le maire Jean-Philippe Périé ne répond pas à la question. Il se contente de nous indiquer, par SMS, que « les caméras fonctionnent conformément aux procédures établies ». Selon Noémie Levain, de l’association la Quadrature du Net, qui milite pour les libertés numériques, les caméras sont pour les maires un outil politique : « Elles leur permettent de montrer à leurs électeurs qu’ils agissent pour leur sécurité. » En trois décennies, la vidéosurveillance s’est imposée comme un incontournable des politiques locales de lutte contre les incivilités et la délinquance.

Cédric Herrou, l’agriculteur qui attaque en justice les caméras de Breil-sur-Roya
Le mouvement débute en 1993, lorsque Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), devient le premier à équiper sa ville de caméras. Il justifie sa décision par une demande des habitants, tandis que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) alerte, déjà, sur de potentielles « atteintes à la vie privée ». Sans grand succès, car, à partir de 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la vidéosurveillance entre dans son âge d’or. Le chef de l’État crée le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), une réserve financière destinée à l’équipement du territoire en dispositifs sécuritaires. Le chercheur Laurent Mucchielli, sociologue et auteur de Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance (éd. Armand Colin, 2018), explique que les préfets ont largement utilisé ce fonds pour « aider les communes à installer des caméras ». En 2009, le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux certifie dans Le Figaro que « la délinquance diminue deux fois plus vite dans les communes équipées de vidéoprotection ». L’affirmation est pourtant contredite en 2020 par la Cour des comptes, qui ne constate « aucune corrélation globale entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance ». De surcroît, les travaux de certains sociologues montrent que, dans le meilleur des cas, les caméras ne font que déplacer de quelques encablures les actes de délinquance vers des zones non surveillées.
Rien n’y fait. Les maires continuent d’acheter des caméras 1. Pour éviter les abus, une commission départementale, incluant les référents sûreté, évalue chaque demande de vidéosurveillance. En théorie, cette instance vérifie que l’installation des caméras est justifiée, adaptée à la délinquance locale, et qu’elle respecte les libertés publiques. En pratique, elle se limite à un contrôle formel. En 2011, la Cour des comptes l’affirme : « Elle ne se rend jamais sur place. De fait, elle n’a aucune marge d’appréciation, et son rôle est exclusivement formel : elle s’assure que le formulaire de demande est correctement rempli et que les pièces exigées sont jointes. »
Le chercheur Guillaume Gormand, auteur d’une étude en 2021 sur la vidéosurveillance pour l’École des officiers de la gendarmerie nationale, détaille, lui, l’action du référent sûreté : « Il réalise le diagnostic qui incite la commune à s’équiper, il juge ensuite que le projet est conforme et donne également un avis sur les subventions publiques accordées. » Autrement dit, commission départementale et référents sûreté fonctionnent en circuit fermé, agissant à la fois comme juge et partie, sans véritable contrôle extérieur. Résultat : des décisions discutables de « préfets qui accordent des autorisations d’installation de caméras dans des quartiers où la délinquance baisse [comme à Marcillac-Vallon], ou dans des communes où son niveau est faible [comme à Breil-sur-Roya] », ainsi que le relève la Cour des comptes.
Plusieurs élus témoignent de la difficulté de résister à ces pressions de l’État. Gilles Ménard, maire de Granville (Manche), refuse encore la vidéosurveillance, mais nous décrit un harcèlement constant : « Je reçois des incitations fortes à nous équiper de la part de la police nationale, du préfet ou du responsable interdépartemental de la police. Alors que, pour nous, la vidéosurveillance n’est pas l’alpha et l’oméga de la sécurité. Nous n’avons pas de caméras, mais notre ville est très bien positionnée dans les classements des villes où il fait bon vivre. »
État et référents sûreté ne sont pas les seuls à faire pression sur les villages français pour qu’ils s’équipent en caméras. Un autre acteur est également en embuscade : l’industrie de la surveillance.
1— Le dernier recensement des caméras, privées comme publiques, réalisé par la Cnil en 2012 en comptabilisait 800 000 sur le territoire.
Des caméras bientôt illégales à Breil-sur-Roya ?
En avril 2024, Cédric Herrou découvre que le maire de Breil-sur-Roya a installé des caméras sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la commission départementale de vidéoprotection, pourtant obligatoire. Il saisit alors la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et engage un recours devant le tribunal administratif. Son référé en urgence est rejeté en août. En parallèle, Cédric Herrou a déposé plainte devant la Cnil et au pénal après avoir constaté que des voyants rouges étaient allumés sur certaines caméras, signifiant, selon lui, qu’elles filmaient. Contacté, le parquet de Nice dit avoir classé cette plainte sans suite pour « absence d’infraction ». En défense, le maire, Sébastien Olharan, assure que « les caméras n’appartiennent pas encore à la commune et ne fonctionnent pas ». Pour le démontrer, il a conduit notre journaliste dans la salle destinée à héberger le centre de supervision, où les écrans censés afficher les flux des caméras restent désespérément noirs. Quelques jours plus tard, la préfecture a fini par accorder l’autorisation d’installer les caméras. Le maire espère pouvoir les activer « avant fin mars ». Mais le recours administratif de Cédric Herrou, qui doit maintenant être étudié sur le fond, s’il aboutit dans quelques mois, pourrait encore tout remettre en question.

Découvrez La Chronique sans plus tarder : recevez un numéro "découverte" gratuit
Remplissez ce formulaire en indiquant votre adresse postale et recevez gratuitement votre premier numéro dans votre boîte aux lettres !







