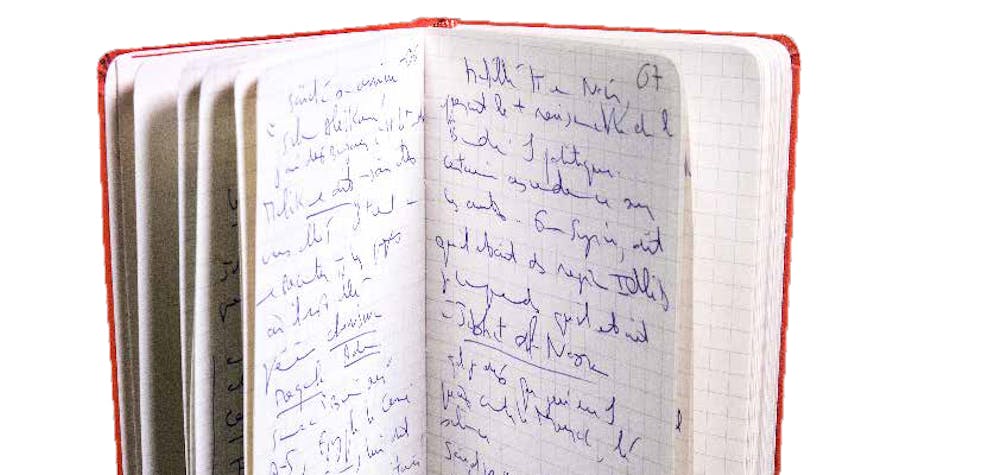Chaque mois, un artiste s’empare d’une histoire qui lui tient à coeur. Avec son regard, sa sensibilité, il nous livre un récit et quelques objets. Le romancier Christophe Boltanski, auteur de La Cache et du Guetteur, inaugure cette rubrique. Il raconte comment une élue locale a tenté de priver Madalina, enfant rom, d’un droit fondamental : aller à l’école.
De grandes boucles d’oreilles, un tee-shirt siglé Givenchy, des cheveux bruns rassemblés en queue de cheval, des joues rondes, des mains potelées, un corps engoncé dans une gangue d’enfant, Madalina est une préado comme les autres, à la fois taiseuse et enjouée, attentive et ailleurs. Elle parle peu, mais ses réponses lapidaires en disent long. Elle habite avec sa famille un appartement sobrement meublé, à Courcouronnes, dans l’Essonne. Chaque matin, elle se rend à son collège, à Ris-Orangis. Elle prend le bus en bas de chez elle. En quatre stations, elle est arrivée. Chaque matin, sa mère, Anita, enceinte de six mois, l’accompagne avec son ventre rond. Devant les autres élèves, Madalina se passerait bien de sa présence. « Je lui dis : “Laisse moi y aller toute seule, mais elle a peur” ». De quoi ? Elle sourit. « Je ne sais pas ». Elle ne le sait que trop.
Ses parents vivent dans la crainte de tant de choses. D’une énième opération de police, d’être séparés de leur fille, de voir une fois de plus les grilles de l’école se refermer devant elle, de perdre leur logement, de courir à nouveau d’un bidonville à un autre, au rythme des arrêtés d’expulsion, d’être renvoyés en Roumanie, leur pays, qui au pire les rejette, au mieux les marginalise. Les Manea appartiennent à la communauté rom. Ils n’aspirent qu’à une vie stable. À 13 ans, Madalina entre en cinquième. Elle a retrouvé ses amis, déclare aimer les maths, l’espagnol, les arts plastiques, un peu moins le français, et fait la fierté de son père : « Ses professeurs m’ont dit qu’elle est très bonne élève », se félicite Vasile, assis en bout de table. Elle trône au milieu. Comme il se doit. Elle est l’héroïne du jour.
Chaque matin, elle exerce un droit dont elle a été spoliée. Elle venait d’avoir 8 ans quand ses parents ont voulu l’inscrire en primaire à Sucy-en-Brie, une ville du Val-de-Marne. Ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir assénée par une employée de mairie. Ce simple « non » proféré derrière un guichet ne relève pas d’une quelconque négligence. Il traduit une politique. Pas d’école pour Madalina et ses semblables. Un déni ordinaire, commis par de nombreuses municipalités, que la justice vient de sanctionner, après cinq ans de procédure et d’innombrables recours. Le 19 juin dernier, la maire de Sucy-en-Brie, Marie-Carole Ciuntu, a été condamnée par la cour d’appel de Versailles pour « discrimination », en raison de son refus de scolariser Madalina et quatre autres enfants de la communauté rom qui campaient sur sa commune. Une première en France. Elle doit verser 1 000 euros d’indemnisation à chacun d’eux.
En ce début septembre, Vasile n’y croit toujours pas. « La maire va donner de l’argent ? » Comme à chaque fois qu’il s’escrime à parler en français, Madalina échange un sourire complice avec son grand frère Ionut. Face à eux, se tient Aline Poupel, une militante infatigable qui a mené le combat en leur nom. Elle préside un collectif de défense des droits des Roms, appelé Romeurope 94. « L’argent, c’est pour votre fille, prévient-elle. Il faudra lui ouvrir un compte à la Poste ». Le père fronce les sourcils. « Comment on fait ça ? »
Les Manea viennent des monts de Buzàu, aux confins de la Transylvanie. La même raison les pousse à quitter leur village pour Bucarest, puis, à émigrer. « Pour nous, il n’y a pas de travail en Roumanie, dit Vasile. Il y en a en France ». Chacun de leur déplacement successif répond à cette nécessité. En 2012, après un long périple, ils débarquent en région parisienne. Ils bivouaquent là où ils peuvent, c’est-à-dire, là où il n’y a rien, dans des bâtiments vides, sur des terrains vagues, dans les moindres interstices de la ville. Entre deux déserts urbains, ils dorment sous un pont ou une porte cochère. À leur arrivée en France, ils ne possèdent pas de caravane, ni même de voiture. Ils ne peuvent pas non plus travailler légalement – ce droit ne sera accordé aux Roms qu’en 2014. Pour subsister, Vasile ramasse de la ferraille qu’il transporte en vélo dans une carriole. Il parcourt cinquante kilomètres par jour avec son deux-roues et sa montagne de déchets. « Pour gagner que dalle, se plaint-il. 20 euros pas plus ». Quand elle ne fait pas la manche, son épouse l’aide à dépiauter les câbles électriques et à démonter des machines à laver. « Elle avait les mains toutes esquintées », se souvient Aline Poupel. « La première fois que je les ai vus, ils étaient à Chevilly-Larue, poursuit-elle. Vous vous souvenez quand vous étiez sous un hangar le long de la Nationale 7 ? » Aubervilliers, la Courneuve, le Blanc-Mesnil… Vasile a perdu le compte des lieux ou plutôt des non-lieux, des espaces indéfinis où il a séjourné avec les siens. « Après, j’ai habité la Bastille », ajoute-t-il, heureux de citer un site chargé d’histoire, sans préciser qu’il est alors à la rue. De chaque endroit, les Manea finissent par être chassés par la police.
En juillet 2014, à la suite d’une nouvelle expulsion, ils échouent à Sucy-en-Brie, une paisible banlieue pavillonnaire. Avec neuf autres familles, ils s’installent sur un lopin en friche, propriété du Réseau ferré de France, en bordure de la ligne du RER. Comme précédemment, ils érigent leur baraque. Quatre murs de bois, une porte, la place pour un matelas, pas davantage. Leur été est bercé par des bruits d’essieux et les aboiements d’un chenil voisin de la police des chemins de fer. De temps en temps, les vigiles s’amusent à les effrayer en laissant traîner leurs molosses près du portail. Début septembre, Aline Poupel rencontre les familles et propose de scolariser leur progéniture. Elle n’a pas de mal à les convaincre. « Je leur dis que les enfants seront en classe, pas dans le bidonville, au milieu des rats. Ils étudieront, auront un repas chaud, se feront des amis. Ça, les parents l’entendent ». Elle repart avec cinq dossiers, celui de Madalina et de quatre garçons âgés de 6 à 10 ans. Avant la rentrée, ils doivent avoir leurs vaccins à jour. Une infirmière s’en occupe deux semaines plus tard.
Le 30 septembre, Aline pousse les portes de la mairie. La personne qui l’accueille lui réclame des justificatifs de domicile. Elle répond que les enfants vivent dans un bidonville, mais peuvent utiliser l’adresse de son association. Quelle que soit leur situation, lui rappelle-t-elle, la commune a le devoir de les scolariser dès lors qu’ils résident sur son territoire. Elle dispose de toutes les pièces requises : passeports, actes de naissance, carnets de vaccination... L’employée va voir sa responsable, revient et, gênée, lui déclare : « Sur ordre du cabinet, aucune inscription de ces enfants n’est acceptée. C’est une décision catégorique du maire ».
Marie-Carole Ciuntu, qui n’a pas répondu à ma demande d’entretien, dirige une ville ancrée à droite depuis des lustres. Avocate, elle connaît la loi. En charge des lycées à la région, elle veille sur l’enseignement. Elle est informée par ses services de la présence d’enfants roms dans le bidonville et vient de signer, une semaine plus tôt, un arrêté d’expulsion. Ses motifs ? « Elle disait qu’il ne fallait pas créer d’appel d’air. “Si on en prend deux, il y en aura dix”, etc. Du grand classique », soupire Philippe Jaloustre qui présidait à l’époque une Fédération de parents d’élèves (FCPE). Ce n’est pas la première fois qu’Aline affronte la maire. « Dès qu’elle a connaissance d’une arrivée de Roms, elle envoie la police municipale pour les faire déguerpir ». En 2010, elle a dû batailler sept mois pour obliger la ville à scolariser deux enfants roms.
Cette fois, elle décide de saisir l’avocat du collectif, Jérôme Karsenti. Par lettre, celui-ci met Marie-Carole Ciuntu en demeure de respecter les multiples textes juridiques, codes, circulaires, conventions internationales, stipulant que « les enfants itinérants ont droit à la même scolarité que les autres », qu’en l’absence de documents, ils bénéficient « d’une admission provisoire », que tout doit être fait pour faciliter leur accès à l’éducation, même pour une courte durée, entre deux départs forcés. Son courrier demeure sans réponse. Un mois et demi plus tard, il saisit la justice au nom des cinq enfants. Commence un long feuilleton judiciaire, rythmé par des relaxes, des appels, des pourvois en cassation. Les autres plaignants retournent en Roumanie ou partent vers des contrées plus clémentes, en Allemagne ou au Canada. Les Manea assistent à chaque procès, malgré leur errance imposée à coup de tampons officiels, de gyrophares et de pelleteuses. Après un campement à Rungis, les voilà à Vitry, dans une ancienne usine. Jusqu’au moment où une porte s’ouvre. En 2016, la famille est acceptée dans un « village d’insertion » à Ris-Orangis. Vasile et son fils apprennent le français et reçoivent une formation. Madalina est enfin admise à l’école. Elle veut aujourd’hui passer son bac. Son frère rénove des bureaux, gare de Lyon. Mais leur père est inquiet. Il ne reçoit plus aucune aide et ne trouve pas de travail. Il ne paye plus le loyer depuis cinq mois. « Ça, c’est un risque », reconnaît Aline. L’expulsion. Elle évite de prononcer le mot et chercher une parade : « Faut remonter un dossier ».
__ Par Christophe Boltanski pour la Chronique d'Amnesty International
Abonnez-vous à La Chronique
pour 3 € par mois, un regard neuf et indépendant sur le monde